Ils ont choisi Israël plutôt que le monde arabe. Israël les a choisis en retour.
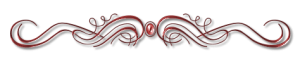

Les Druzes sont la minorité la plus loyale du Moyen-Orient, et Israël est le pays qui les protège.
Dans une région souvent marquée par des conflits sectaires, la relation entre l’État d’Israël et la communauté druze constitue une exception profonde et durable – une fraternité forgée non par commodité, mais par la loyauté, un destin partagé et un respect mutuel.
La communauté religieuse druze est née au Xe siècle comme une émanation de l’islam chiite ismaélien, mais s’est rapidement développée en un groupe ethno-religieux unique et secret, doté de sa propre théologie et de sa propre culture. L’un de ses principes fondamentaux est la loyauté envers le pays de résidence, une stratégie de survie qui a permis aux Druzes d’équilibrer identité et citoyenneté au sein d’empires en mutation.
À l’approche de la fondation de l’État d’Israël en 1948, le monde arabe se mobilisait pour la guerre contre l’État juif naissant. L’espoir dominant parmi les dirigeants arabes, les citoyens arabes de la Palestine mandataire, et même de nombreux responsables juifs, était que les Druzes, villageois arabophones vivant principalement en Galilée et au Carmel, rejoindraient leurs voisins musulmans et chrétiens pour s’opposer à la création d’Israël.
Mais les dirigeants druzes ont vu la situation différemment.
Cheikh Amin Tarif, le chef spirituel et communautaire le plus vénéré des Druzes en Palestine mandataire, était confronté à un choix déterminant : s’aligner sur l’appel de la Ligue arabe à la résistance panarabe, ou tracer une voie indépendante avec l’État juif naissant.
Tarif n’était pas sioniste. Sa principale préoccupation était la sécurité, l’autonomie et la survie de son peuple. Il comprenait que les Druzes, petite minorité religieuse souvent traitée avec suspicion ou indifférence dans le monde arabe, ne seraient guère plus que de la chair à canon dans une guerre qu’ils n’auraient pas déclenchée.
Des réunions secrètes eurent lieu entre des notables druzes et des représentants de la Haganah, précurseur des Forces de défense israéliennes. Alors que de nombreux villages arabes affichaient ouvertement leur hostilité envers les communautés juives, plusieurs villages druzes s’engagèrent à la neutralité, voire à la coopération. En échange, les forces juives s’engageaient à ne pas cibler les zones druzes et à les traiter comme des alliés potentiels, et non comme des ennemis.
La décision du cheikh Amin Tarif de rester neutre au début de la guerre, puis de se ranger ouvertement du côté d’Israël, a changé l’histoire. Il a persuadé les villages druzes d’éviter de participer à la révolte arabe, a facilité le passage des unités de Tsahal dans les zones stratégiques du nord d’Israël et a cultivé une relation durable avec les dirigeants juifs israéliens, dont David Ben Gourion (le Premier ministre fondateur d’Israël).
En 1949, Cheikh Tarif officialisa cet alignement. Il se rendit à la Knesset (Parlement israélien), reconnut la souveraineté d’Israël et affirma le désir de la communauté druze de vivre en citoyens à part entière de l’État. Ce fut une initiative révolutionnaire. Alors que d’autres dirigeants arabes dénonçaient l’existence d’Israël en usant d’un vocabulaire génocidaire, Cheikh Tarif invitait sa communauté à contribuer à sa construction.
Cette décision eut un prix. Les Druzes furent condamnés par les mouvements nationalistes arabes, ostracisés dans certains cercles régionaux et accusés de trahison par leurs compatriotes arabes. Mais le pari du cheikh Tarif, selon lequel Israël traiterait les Druzes comme des citoyens loyaux et non comme des sujets de seconde zone, se révéla juste.
En 1956, à la demande des dirigeants druzes eux-mêmes, le service militaire dans l’armée israélienne est devenu obligatoire pour les hommes druzes. Aucune autre communauté non juive en Israël n’a bénéficié d’une intégration aussi complète au sein de l’appareil de défense.
Les Druzes ont servi avec distinction dans pratiquement toutes les branches de Tsahal, souvent dans des rôles de combat d’élite. En voici quelques exemples :
Général de brigade Amal Asad – Officier druze très respecté, il a servi comme commandant adjoint du Commandement Nord. Il a été l’un des premiers Druzes à atteindre le grade de général de brigade et a contribué à l’élaboration d’une doctrine de sécurité transfrontalière le long de la frontière libanaise.
Colonel Ghassan Alian – Premier officier druze à commander la brigade d’élite Golani, l’une des unités les plus prestigieuses et les plus déployées de Tsahal. Il a dirigé les troupes lors de l’opération Bordure protectrice à Gaza en 2014.
Lieutenant-colonel Ayoub Kara – Ancien officier supérieur des services de renseignement de Tsahal, devenu plus tard membre du Likoud à la Knesset et ministre des Communications, Kara utilisait souvent son arabe druze pour établir des liens dans les relations extérieures d’Israël, notamment avec les États du Golfe et les minorités en Syrie et au Liban.
Le bataillon Herev – Une unité de combat majoritairement druze, aujourd’hui dissoute, qui servait sur les lignes de front du nord. De nombreux soldats druzes ont depuis choisi de servir dans des unités mixtes ou d’élite, témoignant de leur pleine intégration.
Les services de renseignement de Tsahal ( Aman ) et l’unité 8200 recrutent activement des druzes arabophones, dont le dialecte et la connaissance culturelle des communautés syriennes et libanaises voisines offrent des avantages décisifs en matière de renseignement. Ces agents druzes ont joué un rôle essentiel dans la surveillance du Hezbollah, l’infiltration des réseaux arabophones et la traduction en temps réel dans le cadre d’opérations de guerre psychologique et de contre-terrorisme.
Ils ont choisi Israël plutôt que le monde arabe. Israël les a choisis en retour.
Les Druzes sont la minorité la plus loyale du Moyen-Orient, et Israël est le pays qui les protège.
Dans une région souvent marquée par des conflits sectaires, la relation entre l’État d’Israël et la communauté druze constitue une exception profonde et durable – une fraternité forgée non par commodité, mais par la loyauté, un destin partagé et un respect mutuel.
La communauté religieuse druze est née au Xe siècle comme une émanation de l’islam chiite ismaélien, mais s’est rapidement développée en un groupe ethno-religieux unique et secret, doté de sa propre théologie et de sa propre culture. L’un de ses principes fondamentaux est la loyauté envers le pays de résidence, une stratégie de survie qui a permis aux Druzes d’équilibrer identité et citoyenneté au sein d’empires en mutation.
À l’approche de la fondation de l’État d’Israël en 1948, le monde arabe se mobilisait pour la guerre contre l’État juif naissant. L’espoir dominant parmi les dirigeants arabes, les citoyens arabes de la Palestine mandataire, et même de nombreux responsables juifs, était que les Druzes, villageois arabophones vivant principalement en Galilée et au Carmel, rejoindraient leurs voisins musulmans et chrétiens pour s’opposer à la création d’Israël.
Mais les dirigeants druzes ont vu la situation différemment.
Cheikh Amin Tarif, le chef spirituel et communautaire le plus vénéré des Druzes en Palestine mandataire, était confronté à un choix déterminant : s’aligner sur l’appel de la Ligue arabe à la résistance panarabe, ou tracer une voie indépendante avec l’État juif naissant.
Tarif n’était pas sioniste. Sa principale préoccupation était la sécurité, l’autonomie et la survie de son peuple. Il comprenait que les Druzes, petite minorité religieuse souvent traitée avec suspicion ou indifférence dans le monde arabe, ne seraient guère plus que de la chair à canon dans une guerre qu’ils n’auraient pas déclenchée.
Des réunions secrètes eurent lieu entre des notables druzes et des représentants de la Haganah, précurseur des Forces de défense israéliennes. Alors que de nombreux villages arabes affichaient ouvertement leur hostilité envers les communautés juives, plusieurs villages druzes s’engagèrent à la neutralité, voire à la coopération. En échange, les forces juives s’engageaient à ne pas cibler les zones druzes et à les traiter comme des alliés potentiels, et non comme des ennemis.
La décision du cheikh Amin Tarif de rester neutre au début de la guerre, puis de se ranger ouvertement du côté d’Israël, a changé l’histoire. Il a persuadé les villages druzes d’éviter de participer à la révolte arabe, a facilité le passage des unités de Tsahal dans les zones stratégiques du nord d’Israël et a cultivé une relation durable avec les dirigeants juifs israéliens, dont David Ben Gourion (le Premier ministre fondateur d’Israël).
En 1949, Cheikh Tarif officialisa cet alignement. Il se rendit à la Knesset (Parlement israélien), reconnut la souveraineté d’Israël et affirma le désir de la communauté druze de vivre en citoyens à part entière de l’État. Ce fut une initiative révolutionnaire. Alors que d’autres dirigeants arabes dénonçaient l’existence d’Israël en usant d’un vocabulaire génocidaire, Cheikh Tarif invitait sa communauté à contribuer à sa construction.
Cette décision eut un prix. Les Druzes furent condamnés par les mouvements nationalistes arabes, ostracisés dans certains cercles régionaux et accusés de trahison par leurs compatriotes arabes. Mais le pari du cheikh Tarif, selon lequel Israël traiterait les Druzes comme des citoyens loyaux et non comme des sujets de seconde zone, se révéla juste.
En 1956, à la demande des dirigeants druzes eux-mêmes, le service militaire dans l’armée israélienne est devenu obligatoire pour les hommes druzes. Aucune autre communauté non juive en Israël n’a bénéficié d’une intégration aussi complète au sein de l’appareil de défense.
Les Druzes ont servi avec distinction dans pratiquement toutes les branches de Tsahal, souvent dans des rôles de combat d’élite. En voici quelques exemples :
Général de brigade Amal Asad – Officier druze très respecté, il a servi comme commandant adjoint du Commandement Nord. Il a été l’un des premiers Druzes à atteindre le grade de général de brigade et a contribué à l’élaboration d’une doctrine de sécurité transfrontalière le long de la frontière libanaise.
Colonel Ghassan Alian – Premier officier druze à commander la brigade d’élite Golani, l’une des unités les plus prestigieuses et les plus déployées de Tsahal. Il a dirigé les troupes lors de l’opération Bordure protectrice à Gaza en 2014.
Lieutenant-colonel Ayoub Kara – Ancien officier supérieur des services de renseignement de Tsahal, devenu plus tard membre du Likoud à la Knesset et ministre des Communications, Kara utilisait souvent son arabe druze pour établir des liens dans les relations extérieures d’Israël, notamment avec les États du Golfe et les minorités en Syrie et au Liban.
Le bataillon Herev – Une unité de combat majoritairement druze, aujourd’hui dissoute, qui servait sur les lignes de front du nord. De nombreux soldats druzes ont depuis choisi de servir dans des unités mixtes ou d’élite, témoignant de leur pleine intégration.
Les services de renseignement de Tsahal ( Aman ) et l’unité 8200 recrutent activement des druzes arabophones, dont le dialecte et la connaissance culturelle des communautés syriennes et libanaises voisines offrent des avantages décisifs en matière de renseignement. Ces agents druzes ont joué un rôle essentiel dans la surveillance du Hezbollah, l’infiltration des réseaux arabophones et la traduction en temps réel dans le cadre d’opérations de guerre psychologique et de contre-terrorisme.

Soldats du bataillon druze Herev des Forces de défense israéliennes, en 2011 (photo : IDF/Wikipedia)
Il existe également les unités Mista’arvim , composées d’agents d’élite se faisant passer pour des Arabes pour mener des opérations antiterroristes en zones palestiniennes. Mista’arvim s’appuie fortement sur la maîtrise de l’arabe, ou presque, ainsi que sur la familiarité culturelle et l’apparence physique des agents, ce qui leur permet de s’intégrer harmonieusement aux communautés arabes. Cela fait des soldats druzes des atouts particulièrement précieux pour ces unités.
L’arabe druze se distingue des dialectes palestiniens, mais les agents druzes grandissent baignés dans la culture et la langue arabes, ce qui leur confère une intuition et des nuances linguistiques qu’aucune formation théorique ne peut reproduire. Nombre d’entre eux grandissent également dans des communautés mixtes ou adjacentes, développant une compréhension approfondie des normes culturelles, des structures familiales et des dynamiques de rue au sein de la société arabe, essentielle pour le travail d’infiltration.
Bien que la composition exacte de ces unités d’élite soit classifiée, il est bien connu dans les milieux militaires et du renseignement que les soldats druzes ont servi avec distinction dans les opérations de Mista’arvim , en particulier dans :
Surveillance et collecte de renseignements dans les points chauds de Judée-Samarie (également connue sous le nom de Cisjordanie) et de Jérusalem-Est
Raids antiterroristes dans les centres urbains, où se fondre dans la masse est la clé de la surprise et du succès
Rôles d’interrogatoire et de renseignement humain, où le dialecte et le comportement sont essentiels
Ce rôle n’est pas sans complexité. Pour certaines familles druzes, notamment celles dont des proches sont en Syrie ou au Liban, servir dans des unités opérant en territoires arabes ou contre des populations arabes exige une gestion interne prudente. Pourtant, l’éthique druze générale de loyauté envers l’État et la défense d’Israël signifie que la participation des Druzes à ces unités d’infiltration est largement respectée et encouragée au sein de leur communauté.
Les Druzes israéliens ont également gravi les échelons au sein de la police, de la justice et du gouvernement israéliens. Des commandants de la police des frontières aux députés à la Knesset, les citoyens druzes ont joué un rôle essentiel dans la vie civique et nationale d’Israël.
En retour, Israël a reconnu la communauté druze comme une minorité loyale et appréciée, en investissant dans les villes druzes, en reconnaissant les tribunaux religieux druzes et en honorant les Druzes tombés aux côtés des Juifs.
Cette intégration profonde est encore plus remarquable lorsqu’on la compare à la situation des Druzes dans les pays voisins, notamment en Syrie.
Aujourd’hui, la population druze mondiale compte environ un million de personnes, dont plus de la moitié réside en Syrie, principalement dans la province méridionale de Soueida et dans les banlieues autour de Damas, comme Jaramana et Ashrafiyat Sahnaya. Le reste est dispersé au Liban et en Israël, avec environ 150 000 Druzes vivant en Israël et sur le plateau du Golan, conquis à la Syrie lors de la guerre des Six Jours de 1967, puis annexé.
Joshua Hoffman
05/05/2025






Si Arafat s’etait comporté comme les Druzes , plus jamais de problèmes et pourtant tous les dirigeants Israelien de l’époque ne s’étaient jamais privés de lancer des appels a l’intégration .Arafat jouant les cadors avait mis son peuple dans la mouise , jusqu’a aujourd’hui .Les innocents payent toujours .Le grand perdant par sa bonté chretienne naive a commis la pire des fautes en accueillent les troupes barbares d’Arafat apres que Hussein de Jordanie les aient foutut a la porte de son pays .Le pays martyre de cet accueil naif EST ???? LE LIBAN .Completement detruit par les troupes barbares d’Arafat ..