Après le dernier massacre de Druzes par les djihadistes d’Al Jolani dans le sud de la Syrie, Mosab Hassan Youssef, fils d’un dirigeant du Hamas, a partagé une image que j’avais presque oubliée. Il s’agissait de Mohamed Elomar, le musulman australien qui a quitté son pays pour rejoindre Daech et décapiter les « infidèles » pour Allah. Sur la photo de 2021, Elomar se tient triomphant, serrant deux têtes coupées et affichant un sourire diabolique. Mosab a légendé l’image d’un verset glaçant du Coran, Al-Anfal 8:12 : « Je jetterai la terreur dans le cœur des mécréants. Frappez-leur donc la nuque et le bout des doigts. »
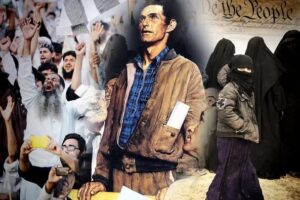
Et une fois de plus, les mêmes questions ont surgi : comment peut-on encore croire, après 47 000 attentats terroristes islamistes depuis le 11 septembre, que l’islam est une religion de paix ? Où est passé le bon sens ? Plus urgent encore : où est passé notre instinct de survie ?
On nous dit – presque rituellement – que l’islam est tout simplement mal compris. Pourtant, sa prétention absolue à tout régir, de l’alimentation à la sexualité en passant par l’au-delà, repose sur deux fondements profondément problématiques : l’idée que Mahomet était l’homme parfait et que le Coran est le livre parfait. Si le Coran est infaillible et définitif, pourquoi produit-il des interprétations si radicalement différentes, des érudits quiétistes aux djihadistes sanguinaires ? Pourquoi le monde islamique est-il si obstinément pris au piège de cycles de violence et si singulièrement réfractaire aux réformes ? Il ne s’agit pas d’énigmes théologiques abstraites. Ce sont des échecs civilisationnels et moraux, et ils exigent des comptes.
La police arrête un homme en lien avec une attaque présumée contre la synagogue de Hagen, dans l’ouest de l’Allemagne, le 16 septembre 2021. Photo : Alex Talash / dpa / AFP

Ce prétendu « malentendu » résulte d’un paradoxe fondamental des écritures et de la tradition islamiques. Le Coran n’est pas un code moral cohérent, mais une fusion calculée de contradictions. Il prêche la paix tout en ordonnant la guerre, offre la tolérance tout en exigeant la soumission. La doctrine du naskh , ou abrogation, accentue cette ambiguïté en permettant aux derniers versets militants de la période médinoise de Mahomet de prendre le pas sur les premiers, plus conciliants, de la Mecque, reflétant la transformation radicale du prophète, de marchand illettré et prédicateur marginal en chef de guerre politique maniant l’épée.
Aujourd’hui, lorsque les modérés affirment « Point de contrainte en religion » (2:256), les radicaux répliquent : « Tuez-les où que vous les trouviez » (2:191) ou « Frappez-leur la nuque » (47:4) – et les deux sont tout aussi valables au sein de la tradition islamique. Cette souplesse théologique permet à l’islam d’être à la fois défendu et instrumentalisé, selon le contexte et l’intention. Pour l’observateur occidental, elle engendre une paralysie cognitive. Pourtant, il n’y a pas de contradiction : c’est une stratégie, et les origines obscures du Coran révèlent sa profondeur. Pendant des siècles, de multiples versions divergentes ont circulé dans le monde islamique, et le processus de standardisation n’a pris fin qu’au XXe siècle. Pourtant, l’orthodoxie islamique affirme que le Coran a été préservé – lettre pour lettre, mot pour mot – depuis l’époque de Mahomet. Mais il s’agit là d’une fiction théologique.
À l’époque médiévale, les érudits musulmans avaient répertorié des centaines de variantes de lectures, ou qira’at , différant par leur conjugaison, leur grammaire, leur vocabulaire et même leur signification juridique ou théologique ; certaines modifiaient les interprétations fondamentales de la doctrine et du droit. Au Xe siècle, l’érudit Ibn Mujahid tenta d’imposer un ordre en canonisant sept lectures « officielles » – portées plus tard à dix –, réduisant ainsi l’éventail des variations acceptables.
Mais l’affaire ne s’arrêta pas là. En 1924, l’université Al-Azhar du Caire, sous l’autorité du roi Fouad Ier, publia la version standardisée la plus récente – et finalement définitive – du Coran, basée sur la version Hafs des qira’at . Cette « édition du Caire » devint la norme dans une grande partie du monde islamique ; un patchwork éditorial moderne, conçu pour des raisons de commodité politique et au service du nationalisme arabe.
Membres du Haut Comité arabe, 1936, un organe dirigeant nationaliste arabe formé pendant le mandat britannique. Dans le sens des aiguilles d’une montre, à partir du haut : Jamal al-Husayni, Hussein Khalidi, Yaqub al-Ghusayn, Fuad Saba, Alfred Roke, Abdul Latif Es-Salah, Ahmed Hilmi, Amin al-Husseini et Raghib al-Nashashibi.
Loin d’être une transmission divine immaculée, le Coran, si souvent décrit comme parfait jusqu’au moindre mot et à la moindre lettre, n’a même pas été écrit du vivant de Mahomet. Il a d’abord été compilé à partir de récitations orales et de fragments épars, puis manipulé, édité et finalement standardisé des siècles plus tard, non pas pour des raisons de clarté religieuse, mais pour le contrôle de l’État.
Et c’est précisément là que prend racine l’impossibilité de réforme.
Contrairement au christianisme, qui s’est fracturé sous le poids des critiques internes et a finalement été tempéré par l’humanisme laïc, l’islam n’a jamais renoncé à son unité de foi, de loi et de pouvoir. Par conséquent, l’interprétation est intrinsèquement politique : celui qui détient l’autorité définit le « véritable islam ».
Là où la réforme occidentale a donné naissance au pluralisme, à la conscience individuelle et à la séparation de l’Église et de l’État, chaque prétendue réforme islamique n’a fait qu’enfoncer la foi dans le littéralisme, le puritanisme et l’extrémisme politique. Le mouvement wahhabite du XVIIIe siècle, souvent décrit comme un renouveau réformiste, était une campagne brutale visant à purger la pratique islamique de la culture locale, du mysticisme et de la flexibilité. Il en a résulté le fascisme religieux, et son héritage idéologique perdure en Arabie saoudite et dans le terrorisme qu’il a exporté. Les Frères musulmans du XXe siècle ont émergé sous la bannière du modernisme, mais leur véritable héritage a été l’islamisation de la politique et la politisation de l’islam. Ses enfants sont le Hamas, le projet néo-ottoman d’Erdogan et d’innombrables mouvements djihadistes. Le salafisme postcolonial, porté par l’argent du pétrole du Golfe, s’est paré d’authenticité tout en effaçant des siècles de pluralisme intellectuel et en le remplaçant par un dogme du désert.
En d’autres termes, la réforme de l’islam n’est pas synonyme de progrès. Elle signifie purification. Elle efface le mysticisme, les identités hybrides et les adaptations régionales au profit de l’austérité imaginée de l’Arabie du VIIe siècle. Il ne s’agit pas de réforme, mais de re-salafisation. Et c’est précisément pourquoi le monde islamique demeure si violent.
Les survivants yézidis du génocide des Ezidikhans, perpétré par des militants islamistes, restent bloqués dans des camps de déplacés dans le nord de l’Irak. La reconstruction, le retour et les demandes de justice et de responsabilité pour ce génocide perpétré par les islamistes se poursuivent, mais lentement.
Tandis que le reste du monde évoluait, l’islam a conservé sa structure théopolitique. Sa loi – la charia – est toujours considérée comme divine et non négociable. Son idéal politique – le califat – n’est pas une relique du passé, mais un objectif sacré. Son identité fondamentale n’est pas individuelle et fondée sur les droits, mais collective et liée à l’honneur. Chaque tentative de modernisation dans le monde islamique a été imposée par la force coloniale ou par des autocrates laïcs, sans jamais être véritablement intériorisée. Et dès que la pression extérieure s’est atténuée, l’islam s’est réaffirmé – non pas comme une foi personnelle, mais comme un système global. Le vide laissé par le retrait colonial n’a jamais été comblé par la démocratie libérale, mais par le djihadisme, qui s’est présenté à la fois comme une résistance et une restauration.
Cela devient d’autant plus évident lorsqu’on compare le monde islamique à d’autres sociétés postcoloniales. L’Inde, le Brésil, le Mexique, la Corée du Sud et même certaines régions d’Afrique subsaharienne ont tous subi le colonialisme, l’esclavage et l’exploitation. Pourtant, ils ont bâti des démocraties, développé des institutions, développé des systèmes éducatifs et accueilli favorablement le pluralisme. Bien que confrontés à des défis, ils ne sont pas prisonniers d’une violence religieuse cyclique ni figés dans une époque théocratique.
Le monde islamique, en revanche, reste en proie à des coups d’État militaires, à des régimes dynastiques et à la répression théocratique. Les sociétés gouvernées par des religieux – ou soumises à la charia – continuent d’appliquer l’interdiction de l’apostasie, les crimes d’honneur, l’apartheid sexuel et des châtiments médiévaux barbares. Il ne s’agit pas d’anomalies marginales, mais de caractéristiques systémiques. Et dans bien des cas, elles persistent malgré l’immense richesse pétrolière, car la richesse sans institutions modernes ne favorise pas le progrès ; elle alimente la corruption, la répression et l’absolutisme religieux. La vie intellectuelle est étouffée. Le discours critique est inexistant. La censure règne. Il ne s’agit pas de vestiges du colonialisme occidental, mais de pathologies endémiques, ou plus précisément, des effets persistants du colonialisme islamique qui a effacé des siècles de diversité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
Des femmes membres du groupe paramilitaire iranien Bassidj – la soi-disant « police des mœurs » du régime – défilent armées lors d’un rassemblement anti-israélien à Téhéran, le 10 janvier 2025, exprimant leur solidarité avec les factions palestiniennes et libanaises. (Photo : AFP)

L’idée selon laquelle le colonialisme expliquerait le sous-développement islamique s’effondre à l’examen. Si cela était vrai, l’Inde ne serait pas une démocratie pluraliste. Le Mexique et le Brésil ne se seraient pas industrialisés. La Corée du Sud ne serait pas une puissance technologique. Pourtant, le Pakistan, fondé comme État islamique, a sombré dans une théocratie paranoïaque et militarisée où les touristes peuvent être brûlés vifs sur de vagues accusations de blasphème. L’Iran, sous le Shah, était sur la voie de la modernisation laïque, jusqu’à ce que la révolution de 1979 le transforme en théocratie cléricale. L’Afghanistan est devenu non seulement le cimetière des empires, mais aussi celui des droits des femmes. Libye, Syrie, Yémen, Soudan : la liste des États islamiques en faillite s’allonge chaque décennie.
En réalité, la civilisation islamique résistait déjà aux réformes bien avant la colonisation occidentale – alors qu’elle était elle-même une force impériale, colonisant de vastes territoires et asservissant des millions d’Africains et d’Européens avec une barbarie impitoyable. Les premières conquêtes islamiques ont soumis les grandes civilisations de Perse, de Byzance et d’Égypte, arabisant et islamisant de force de vastes régions du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et de vastes régions d’Afrique subsaharienne. Les crises qui paralysent aujourd’hui le monde islamique ne sont pas des vestiges coloniaux ; elles sont ancrées dans son architecture doctrinale : un système juridique rigide et sacralisé ; une domination cléricale sur la vie civile ; la suppression de la raison indépendante ( ijtihad ) ; et un code culturel pathologique ancré dans l’honneur, la honte et l’obéissance.
Même le prétendu « Âge d’or » de l’islam ne fut pas le triomphe de l’orthodoxie, mais celui de tribunaux persanisés et à la gouvernance souple, qui toléraient la recherche philosophique et absorbaient la richesse intellectuelle des peuples conquis. Lorsque les clercs reprirent le pouvoir, les portes de la pensée critique se refermèrent – et elles le restèrent depuis.
Les apologistes occidentaux et les théoriciens postcoloniaux continuent d’imputer les crises du monde islamique aux interventions étrangères, au sionisme et à l’héritage de l’empire. Mais l’introspection, condition première de la croissance, est idéologiquement interdite. Le Coran décrit la communauté musulmane comme « le meilleur des peuples » (3:110). L’échec ne peut être interne ; il doit donc être imputé à l’Occident, aux Juifs, aux apostats. La critique devient blasphème ; la réforme devient trahison. Et la stagnation devient fatalité.
La question n’est plus de savoir si l’islam a besoin d’être réformé. La question est de savoir s’il en est capable. Et, plus urgent encore, pourquoi, en Occident, continuons-nous à prétendre le contraire ?
Giovanni Lupo
28/07/2025
![]()
AIDEZ MINURNE !…
Minurne fonctionne sans recettes publicitaires.
Si vous appréciez nos articles, vous pouvez nous aider par un don de 5 €,10 €, 20 € (ou plus).
Cliquez ci-dessous (paiement Paypal sécurisé)



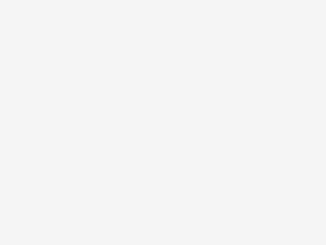
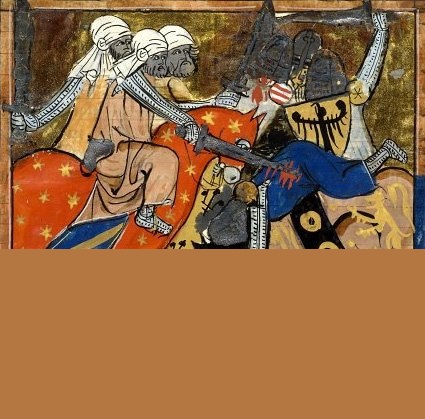
Soyez le premier à commenter